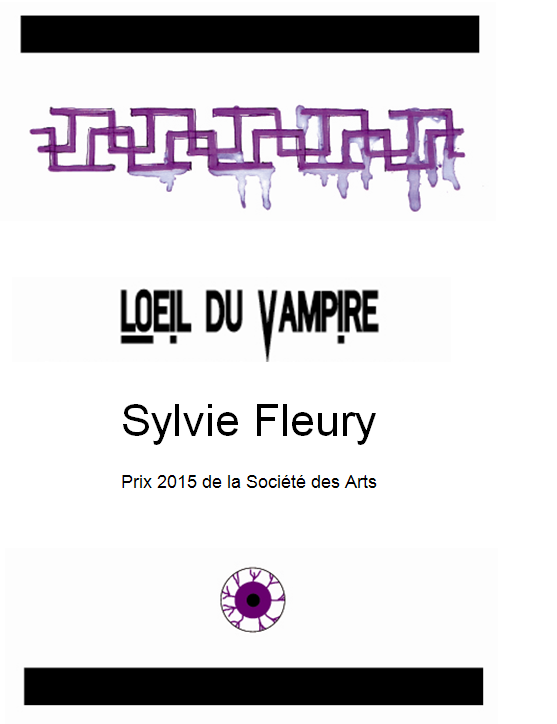L’ŒIL DU VAMPIRE
Le Prix 2015 de la Société des Arts récompense Sylvie Fleury pour l’ensemble de son œuvre et la poursuite de ses recherches. Reconnue internationalement pour son travail, figure marquante des années 1990-2000 par son regard acerbe sur la société de l’art, l’artiste genevoise est encouragée à développer encore son travail original.
La soirée de remise du Prix 2015 a eu lieu le jeudi 24 septembre
18:30 Cérémonie de remise de Prix à la Salle des Abeilles
19:00 Vernissage à la Salle Crosnier
19:30 Cocktail dans les Salons
20:00 « Live Modular Synthesis by » performance par Russell Haswell
>> Cérémonie et vernissage, compte-rendu et photos
Exposition à la Salle Crosnier du 25 septembre au 31 octobre 2015
du mardi au vendredi de 15h00 à 19h00 et le samedi de 14h00 à 18h00
(jours fériés inclus)
Sylvie Fleury a intitulé son dernier projet « L’Œil du Vampire ». Son exposition au Palais de l’Athénée à Genève renvoie avec détachement et humour aux métaphores que l’artiste infiltre dès la fin des années 80 dans le monde de l’art. Cette exposition est liée à l’attribution cette année du Prix de la Société des Arts, qui lui permet de publier aussi une importante monographie aux éditions JRP Ringier.
Déjà le titre, l’Œil du Vampire, qui pourrait être celui d’une série Z ou d’un film gore, souligne que si Sylvie Fleury a été cette année membre du jury du Festival du film fantastique de Neuchâtel ce n’est pas simplement par hasard. En effet, depuis toujours, l’artiste est convaincue que les lieux d’art sont des espaces propices au surgissement de l’étrange et du merveilleux. De la grotte aux catwalks des défilés de mode, du garage aux luxueuses boutiques, de la base d’ovnis aux musées classiques, l’artiste aime imaginer, comme dans les films d’angoisse que, comme le répètent de manière lancinante les héros de X-Files, la vérité est ailleurs. Elle nous entraîne alors avec elle. Elle se joue des configurations des espaces qui lui sont ouverts. Ici, dans ce palais historique, elle semble vouloir contrer les forces fantomatiques en libérant des vampires.
L’Œil du Vampire est peut-être le regard de l’artiste. En posant sur le monde plongé dans l’obscurité un œil attentif, l’artiste perce les mystères, traverse les cloisons et s’octroie alors le droit de s’en nourrir et de tenter de transformer. Sylvie Fleury n’a de cesse depuis ses débuts, de nous inciter à oser nous saisir du réel, de nous en gorger et de ne croire à aucune des limites contre lesquelles notre regard croit devoir s’arrêter. C’est avec plaisir, délicatesse et conscience qu’elle va explorer les failles du monde de l’art essentiellement machiste que son statut de femme artiste lui laisse apparemment libres. Elle réécrira, par exemple, en plusieurs tomes l’histoire de l’art en faisant du shopping. Car, et on l’ignore trop souvent, chaque installation de Shopping Bag n’est rien d’autre qu’une petite accumulation d’objets renvoyant aux poncifs masculins de l’histoire de l’art. Ainsi, si nous avions son œil de vampire, pourrions-nous trouver dans les cabas des montres molles, des robes quadrillées, des escarpins monochromes. Mais c’est aussi ce regard qui l’autorise à se saisir de nombre de travaux d’artistes historiques, qu’elle admire par ailleurs, pour les féminiser. Elle vampirise alors des œuvres de Carl Andre en marchant sur les sculptures en talons aiguille ou en y écrasant des maquillages. Elle fait éclater le rythme vertical, emblématique de Daniel Buren, en y ouvrant des béances suggestives. Elle adoucit les angles de sculptures de Donald Judd en en faisant dégouliner d’étranges matières pailletées. Elle joue de l’élégance des structures de Mondrian en faisant porter à des modèles des robes qui s’en inspirent. Elle parodie l’héroïsme gestuel des peintres de l’après-guerre en réalisant un plafond en dripping de fond de teint. Nous pouvons croire que le regard de Sylvie Fleury porte au delà de ses propres contingences.
À moins que ce soit le contraire et que l’artiste et le public sensible ne soient entourés que d’êtres hostiles qui n’hésitent pas à se saisir de tous les espaces créatifs pour les faire basculer dans une nuit de consommation vorace. Selon ce modèle suranné l’artiste ne serait alors qu’une victime fraîche et blanche autours de laquelle volètent et piquent des êtres malveillants et impures mus par l’appât du gain. Peut-être Sylvie Fleury sait-elle mieux que personne que cet effet de miroir n’appelle aucun discours moral ou désenchanté, mais qu’il s’agit là de bien petits monstres, produits par nos perceptions et nos propres angoisses. Si le désir produit les valeurs d’échange nous pouvons, par contre, continuer à en jouer. Ainsi, depuis ses débuts, Sylvie Fleury n’a jamais boudé son plaisir à faire usage du langage et des codes des créateurs de mode et des grandes maisons de luxe. C’est sans peur, ni échelle paranoïaque de valeurs, qu’elle parcourt des magazines de mode au bord d’une piscine, qu’elle essaie ses chaussures dans son dressing, réplique des objets emblématiques de certaines collections saisonnières en bronze chromé, fait tirer des filles à la Kalachnikov sur des sacs de luxe, utilise les gammes chromatiques poudreuses de certaines maisons de maquillage comme couleur de fond, détourne certains slogans publicitaires. Bref, elle fait usage de sa liberté sans complexe ajoutant à sa palette tout ce qui fait son quotidien et celui de presque chacun d’entre nous.
Mais le titre de l’exposition est aussi presque une description littérale de deux sculptures inspirées par un petit vampire de dessin animé. Les petits animaux de résine, blancs et roses, sont posés sur un rocher, tenant chacun dans ses griffes un gros œil qui peut lui échapper mais est retenu par une ficelle, comme dans le jouet que Sylvie Fleury a agrandi. Ces petits personnages aussi apparemment inoffensifs qu’apparemment naïfs, nous renvoient aussi, une fois de plus, à sa capacité à apprivoiser les esprits, même ceux qui pourraient sembler être les plus malveillants. Ainsi, comme dans les miroirs parfois utilisés dans les rites chamaniques, l’artiste n’hésitera jamais à nous mettre face aux ombres de nos regards attendus sur elle et son travail. Elle dresse alors un portrait drôle et spirituel de l’image à laquelle elle a pu être trop souvent réduite. Ainsi, marquant le cœur de la grande rétrospective que lui consacra, il y a quelques années, le Mamco à Genève, elle imagina une pièce intitulée Rétrospective composée de deux armoires (dont une est la reproduction à l’échelle 1:1 d’un élément de sa bibliothèque) contenant une sélection de chaussures. Elle produira, sur le même principe, un grand néon avec les remarques les plus acerbes qu’elle trouva dans le livre d’or de sa première exposition monographique dans une galerie new-yorkaise (« Please, no more of this kind of stuff ») ou se fera portraiturer d’après un scan en 3D pilotant une libellule de carrousel. L’artiste, en détournant notre regard, est donc capable de disposer de son identité, de se forger un personnage complexe.
Pour Sylvie Fleury les œuvres d’art, autant que nos actes et les lieux que nous traversons, se chargent d’énergie et c’est peut-être là leur seule raison d’être. C’est ce que révèle de manière délicate et étrange la frise peinte, surdimensionnée et mouvementée, qui module la très classique salle d’exposition du palais de l’Athénée. Le motif très géométrique découpe l’espace et se liquéfie dans une matière aussi inquiétante qu’attirante. La salle entière devient dessin et se dématérialise. Si tout paraît si simple et léger, c’est pourtant le résultat d’une décantation lente, la révélation d’une vibration aussi instable qu’invisible de prime abord. La technique et les motifs choisis rendent visibles les vies successives du lieu. Les personnages posés sur le très beau plancher deviennent les gardiens d’un espace hors d’âge, comme ceux vers lesquels l’artiste a souvent été attirée. Cette salle emblématique de la pensée de l’art au 19e siècle, rejoint dans son étrange vibration les grottes parfois mises en scène ou factices que l’artiste parcourt depuis quelques années.
Dans cette exposition semble résonner une petite musique, une ritournelle douce un peu inquiétante. Car si aucun statement récurrent chez Sylvie Fleury n’est réellement énoncé ici, sauf à considérer le titre de l’exposition, les deux personnages semblent tirés d’une comptine, d’une historiette, comparable à celle lancinante parfois utilisée dans les rites chamaniques. Ils sont dans le délicat équilibre entre le familier et l’inquiétant, le simple et le sophistiqué. Cet étrange décollement du réel est aussi celui dans lequel Sylvie Fleury se met souvent. Lorsqu’elle détourne, par exemple, en décontextualisant des slogans publicitaires trouvés ou des inscriptions prélevées dans son quotidien. En se les appropriant, elle leurs accorde une place réelle en écho parfois à sa biographie et à son parcours artistique. Par là, elle nous les transmet aussi comme de petite formule magique que nous pouvons faire nôtres. Il est facile d’imaginer qu’elle engage à suivre certains de ses préceptes Be good be bad just be, qu’elle nous suggère de prendre de la distance face à nos propres attentes de visiteurs et de collectionneurs, Salad, Salad, Salad ; Moisturizing is the Answer ; Do not think of the Colour Blue for 30 Seconds et nous libère, dès sa première pièce de toutes nos appréhensions : C’est la vie.
Mais, peut-être et avant tout cette exposition, comme toutes ses expositions est-elle une occasion pour Sylvie Fleury de nous rappeler qu’il ne s’agit là que d’un temps suspendu. L’artiste nous a souvent rappelé que son statut lui permet d’envisager, entre autres, que son espace privé rejoigne d’une manière ou d’une autre un espace apparemment public. Ses œuvres ont la texture d’objets familiers. Elles ne s’inscrivent que pour un temps dans un espace neutralisé avant qu’elles ne puissent se matérialiser dans une proximité différente, rejouer par effet de collage l’étrangeté du regard premier qui les a conçus. Ainsi, les champignons colorés que l’artiste a tirés de son imaginaire pour les faire exploser en une multitude de lieux et en différents formats.
Sylvie Fleury souligne depuis quelques années que l’exposition n’est peut-être malheureusement pas autre chose que la translucide enveloppe qui permet de maintenir une énergie déployée sous une forme par trop amorphe. Ainsi sa dernière exposition parisienne Camino del Sol, présentait les reliquats d’une performance. Celle-ci, structurée par un complexe système musical produit par les actions des performeuses, mettait en scène différents archétypes féminins et faisait apparaître l’évocation fulgurante et merveilleuse de la Danse serpentine de Loïe Fuller, tranchant par sa fluidité et sa blancheur spectrale avec différentes figures féminines aux mouvements lancinants et répétitifs. Les objets, l’exposition en soi, gardaient la mémoire de cette performance aussi forte, sourde qu’impulsive.
C’est cette pulsation que rend aussi perceptible cette exposition. Si pour beaucoup Sylvie Fleury a posé sur le monde un filtre argenté et lisse, c’est oublier son engagement et son plaisir à faire sauter les frontières et les barrières, provoquer les résistances et affirmer comme elle le faisait avec ses amies, membres de leur club de custom les She Devils on Wheels qu’il n’est aucune identité sur laquelle on ne puisse avoir prise. Il est bien question pour Sylvie Fleury d’affirmer que tout peut être customisé, même sa propre vie.
Peut-être que l’œil du vampire est celui que l’on devrait poser sur notre espace quotidien. Il ne tient qu’à nous de transcender nos propres limites, d’être ultra-lucides et de ne pas nous laisser enfermer dans des stéréotypes dont nous sommes aussi, étrangement, les défenseurs. L’art est un espace que nous pourrions simplement occuper.
Samuel Gross